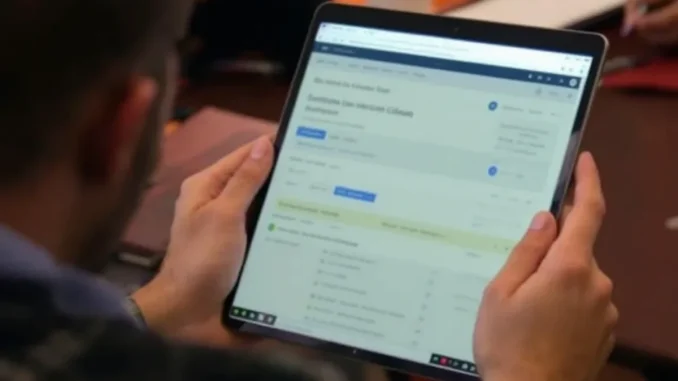
La transition vers un modèle économique plus respectueux des ressources naturelles constitue un défi majeur de notre époque. L’économie circulaire territoriale s’impose comme une réponse cohérente face à l’épuisement des matières premières et aux défis environnementaux. Ce modèle économique, fondé sur la réduction, le réemploi et le recyclage, nécessite un cadre juridique adapté pour se développer pleinement. La protection juridique de l’économie circulaire territoriale mobilise des instruments variés, allant des réglementations européennes aux initiatives locales, en passant par les dispositifs nationaux. Cette protection s’articule autour de plusieurs axes: encadrement des déchets, responsabilisation des producteurs, soutien à l’innovation écologique, et gouvernance territoriale adaptée.
Fondements juridiques de l’économie circulaire en droit français et européen
L’apparition de l’économie circulaire dans le paysage juridique français s’est faite progressivement. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 marque une étape décisive en consacrant pour la première fois ce concept dans notre droit. Cette reconnaissance s’est ensuite approfondie avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de 2020, qui constitue le socle législatif principal en la matière.
Du côté du droit européen, le Pacte vert (Green Deal) et le Plan d’action pour l’économie circulaire de 2020 forment le cadre stratégique communautaire. Ces textes s’articulent avec diverses directives sectorielles, notamment la directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE, modifiée en 2018), qui établit la hiérarchie des modes de traitement et fixe des objectifs ambitieux de recyclage.
L’articulation entre ces différents niveaux normatifs s’avère complexe. Le droit français transpose les exigences européennes tout en développant des spécificités nationales. Ainsi, la loi AGEC va parfois au-delà des minima européens, notamment en matière de lutte contre l’obsolescence programmée ou d’interdiction de certains plastiques à usage unique.
Une protection juridique en construction
Le cadre juridique actuel repose sur plusieurs piliers fondamentaux :
- La hiérarchie des modes de traitement des déchets, privilégiant la prévention, puis la réutilisation, le recyclage, et en dernier recours l’élimination
- Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), qui fait porter sur les metteurs sur le marché la charge financière de la gestion des déchets issus de leurs produits
- Les obligations d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits
- Les incitations fiscales favorisant les comportements vertueux
Ces principes se déclinent ensuite dans des dispositifs sectoriels. Par exemple, le Code de l’environnement comporte désormais un titre entier dédié à la prévention et à la gestion des déchets, avec des dispositions spécifiques selon les filières. La commande publique intègre progressivement des critères d’économie circulaire, grâce notamment au décret n° 2021-254 du 9 mars 2021.
Toutefois, cette construction juridique présente encore des lacunes. La notion même d’économie circulaire reste imprécise en droit, ce qui peut générer des incertitudes d’interprétation. Les objectifs fixés par les textes manquent parfois de contraintes effectives, limitant leur portée opérationnelle. De plus, la multiplicité des textes et leur dispersion dans différents codes (environnement, consommation, collectivités territoriales) complexifient l’appréhension globale du régime applicable.
Outils juridiques au service des territoires circulaires
Les collectivités territoriales disposent d’un arsenal juridique croissant pour mettre en œuvre l’économie circulaire à l’échelle locale. Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) constitue l’outil de planification principal. Intégré au Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), il fixe les orientations en matière de prévention, recyclage et valorisation des déchets.
Les documents d’urbanisme locaux peuvent intégrer des dispositions favorables à l’économie circulaire. Ainsi, les Plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent réserver des espaces pour les activités de recyclage ou de réemploi, ou imposer des performances environnementales renforcées pour les constructions nouvelles. Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) peut quant à lui définir une stratégie territoriale intégrant les flux de matières.
Les marchés publics constituent un levier d’action majeur. Le Code de la commande publique permet désormais d’intégrer des critères environnementaux dans les appels d’offres. Les acheteurs publics peuvent favoriser les produits issus du réemploi ou incorporant des matières recyclées, grâce notamment à l’article L. 2112-2 qui autorise des spécifications techniques environnementales.
Dispositifs contractuels et partenariats territoriaux
Au-delà de ces outils réglementaires, les contrats jouent un rôle croissant dans la structuration des filières d’économie circulaire :
- Les contrats de transition écologique (CTE) permettent de formaliser des engagements entre l’État, les collectivités et les acteurs socio-économiques
- Les conventions territoriales avec les éco-organismes facilitent le déploiement des filières REP
- Les sociétés d’économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL) offrent des cadres juridiques adaptés pour porter des projets d’économie circulaire
La coopération intercommunale s’avère souvent indispensable pour atteindre une échelle pertinente. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exercent généralement la compétence déchets, mais peuvent aussi développer des actions en matière de développement économique circulaire. La loi Engagement et Proximité de 2019 a renforcé les possibilités de coopération entre communes et intercommunalités.
Ces différents outils juridiques permettent aux territoires d’adapter leur stratégie d’économie circulaire à leurs spécificités locales. Cependant, leur efficacité dépend largement de la volonté politique et de la capacité à mobiliser les acteurs locaux. Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) constituent à cet égard des structures intéressantes pour fédérer entreprises, collectivités et associations autour de projets d’économie circulaire.
Régulation des flux de matières et responsabilisation des acteurs économiques
La traçabilité des flux de matières constitue un enjeu fondamental de l’économie circulaire territoriale. Le droit impose désormais des obligations de suivi pour de nombreux types de déchets. Le registre national des déchets, prévu par l’article L. 541-7 du Code de l’environnement, vise à centraliser les informations sur les flux. Pour certains déchets dangereux, un bordereau de suivi doit accompagner chaque transfert, assurant une traçabilité complète.
Cette traçabilité s’étend progressivement en amont, avec des exigences accrues concernant la composition des produits. La loi AGEC a ainsi instauré une obligation d’information sur la présence de substances dangereuses dans les produits, facilitant leur recyclage ultérieur. De même, l’indice de réparabilité, puis l’indice de durabilité, visent à informer le consommateur sur la durée de vie potentielle des produits.
La responsabilité élargie du producteur (REP) constitue un pilier majeur du dispositif juridique. Ce principe, codifié à l’article L. 541-10 du Code de l’environnement, fait porter sur les producteurs, importateurs et distributeurs la responsabilité de la gestion des déchets issus de leurs produits. Concrètement, ces acteurs doivent soit mettre en place des systèmes individuels de collecte et traitement, soit adhérer à un éco-organisme agréé par l’État.
Extension des filières REP et modulation des éco-contributions
Le champ d’application des filières REP s’est considérablement élargi ces dernières années :
- Les emballages ménagers, première filière historique (1992)
- Les équipements électriques et électroniques (DEEE)
- Les textiles, linge de maison et chaussures
- Les jouets, articles de sport et de bricolage (depuis 2022)
- Les matériaux de construction du secteur du bâtiment (depuis 2023)
L’efficacité de ces filières repose largement sur le mécanisme de modulation des éco-contributions. Les producteurs paient des contributions variables selon les caractéristiques environnementales de leurs produits (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, durée de vie). Cette modulation, renforcée par la loi AGEC, constitue une incitation économique puissante à l’éco-conception.
Au-delà de la REP, d’autres mécanismes de responsabilisation des acteurs économiques se développent. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) intègre de plus en plus la dimension circulaire. La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères impose aux grandes entreprises d’identifier et prévenir les risques environnementaux liés à leurs activités et à celles de leurs sous-traitants.
Les obligations de reporting extra-financier, notamment issues de la directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), contraignent les entreprises à communiquer sur leurs impacts environnementaux, y compris leur consommation de ressources et leur production de déchets. Ces informations, accessibles aux consommateurs et investisseurs, créent une pression supplémentaire vers des modèles plus circulaires.
Protection juridique de l’innovation circulaire et des nouveaux modèles économiques
L’innovation joue un rôle déterminant dans la transition vers l’économie circulaire territoriale. Le droit doit à la fois l’encourager et l’encadrer. Les incitations fiscales constituent un premier levier d’action. Le crédit d’impôt recherche (CIR) peut s’appliquer aux travaux de R&D liés à l’économie circulaire. Des taux réduits de TVA s’appliquent à certaines activités de réparation ou de réemploi. L’ADEME propose des aides financières pour les projets innovants d’économie circulaire, dans un cadre juridique sécurisé.
Les dérogations expérimentales permettent de tester de nouveaux modèles avant leur généralisation. L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement autorise ainsi des expérimentations dérogatoires en matière de gestion des déchets, sous réserve d’un encadrement strict. Ces dispositifs permettent d’innover tout en garantissant la protection de l’environnement et de la santé publique.
La propriété intellectuelle joue un rôle ambivalent. Si les brevets protègent les innovations technologiques circulaires, ils peuvent parfois constituer des obstacles au réemploi ou à la réparation. La loi AGEC a ainsi limité certains effets restrictifs des droits de propriété intellectuelle, notamment en interdisant les clauses contractuelles limitant la réparation des produits.
Encadrement juridique des nouveaux modèles d’affaires circulaires
De nouveaux modèles économiques émergent, nécessitant des adaptations juridiques :
- L’économie de fonctionnalité, qui substitue la vente d’un usage à celle d’un bien, bouleverse les catégories juridiques traditionnelles
- Le réemploi et la réutilisation soulèvent des questions de responsabilité et de garantie
- Le reconditionnement nécessite un cadre juridique spécifique, distinct de celui des produits neufs
La loi AGEC a commencé à répondre à ces enjeux. Elle a notamment clarifié le statut juridique des pièces détachées d’occasion et renforcé l’obligation de proposer des pièces issues de l’économie circulaire pour la réparation. Elle a également créé un fonds de réparation, alimenté par les éco-contributions, pour réduire le coût des réparations pour les consommateurs.
La question de l’obsolescence programmée illustre cette approche protectrice. Définie à l’article L. 441-2 du Code de la consommation comme « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit », elle constitue désormais un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. La charge de la preuve reste toutefois difficile à établir, ce qui limite l’efficacité de cette protection.
Les labels et certifications jouent un rôle croissant dans la sécurisation juridique de ces nouveaux modèles. Le label Répar’acteurs, le label Emmaüs pour le réemploi, ou encore la certification Economie Circulaire de l’AFNOR permettent de valoriser les démarches vertueuses tout en garantissant leur sérieux. Ces dispositifs volontaires complètent utilement le cadre réglementaire contraignant.
Défis de l’application territoriale et perspectives d’évolution du cadre juridique
La mise en œuvre effective de l’économie circulaire sur les territoires se heurte à plusieurs obstacles juridiques. La gouvernance multi-niveaux complexifie parfois l’action locale. Régions, départements, intercommunalités et communes interviennent sur des aspects complémentaires de l’économie circulaire, sans que la coordination soit toujours optimale. La loi NOTRe a clarifié certaines compétences, mais des zones de flou persistent.
Les contradictions normatives constituent un autre frein. Ainsi, certaines normes sanitaires ou de sécurité peuvent entrer en conflit avec les objectifs de réemploi ou de recyclage. Par exemple, la réglementation sur les matériaux au contact des aliments limite parfois les possibilités de réutilisation d’emballages. Ces tensions nécessitent des arbitrages juridiques délicats entre protection du consommateur et préservation des ressources.
Le contrôle et les sanctions restent des points faibles du dispositif actuel. Si le cadre légal prévoit des infractions (non-respect des obligations REP, gestion illicite de déchets, etc.), les moyens humains et matériels des services d’inspection sont souvent insuffisants. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les inspecteurs de l’environnement peinent à couvrir l’ensemble du territoire.
Perspectives d’évolution et recommandations
Plusieurs pistes d’amélioration du cadre juridique se dessinent :
- Renforcer la coordination interterritoriale par des dispositifs juridiques adaptés (contrats de réciprocité, pôles métropolitains…)
- Développer les droits d’usage collectifs sur certaines ressources, inspirés des communs
- Intégrer plus fortement les principes de l’économie circulaire dans la fiscalité locale
- Simplifier les procédures administratives pour les initiatives d’économie circulaire de petite échelle
La dimension européenne de cette protection juridique va probablement se renforcer. Le nouveau plan d’action pour l’économie circulaire de l’Union européenne prévoit de nombreuses initiatives réglementaires, notamment un cadre pour les produits durables et une révision de la directive sur l’écoconception. Ces évolutions auront un impact direct sur le droit français et les pratiques territoriales.
Le contentieux lié à l’économie circulaire pourrait se développer dans les prochaines années. Les associations environnementales utilisent de plus en plus les recours juridiques pour faire respecter les obligations légales. Les class actions, introduites en droit français par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, pourraient être mobilisées contre des pratiques contraires à l’économie circulaire, comme l’obsolescence programmée.
La soft law continuera de jouer un rôle complémentaire à la réglementation contraignante. Les chartes, engagements volontaires et contrats de filière permettent d’anticiper les évolutions réglementaires et d’adapter les exigences aux spécificités sectorielles ou territoriales. Ces instruments, bien que non contraignants juridiquement, créent des dynamiques vertueuses et préparent le terrain pour des obligations futures.
Vers une protection juridique intégrée et systémique de l’économie circulaire
L’évolution du cadre juridique de l’économie circulaire territoriale tend vers une approche plus intégrée. La fragmentation actuelle des dispositions entre différents codes (environnement, consommation, urbanisme, collectivités territoriales) nuit à la lisibilité et à la cohérence d’ensemble. Une codification transversale, ou du moins une meilleure articulation entre ces différents corpus, renforcerait l’efficacité du dispositif.
Le passage d’une logique de gestion des déchets à une véritable gestion des ressources constitue une mutation profonde de notre système juridique. Cette évolution implique de repenser certains concepts fondamentaux, comme la propriété ou la responsabilité. Le droit des déchets, historiquement centré sur les enjeux sanitaires et environnementaux liés à leur élimination, doit désormais intégrer pleinement leur potentiel comme ressources.
L’approche par les flux plutôt que par les objets pourrait transformer notre cadre juridique. Le métabolisme territorial, qui analyse les flux de matières et d’énergie à l’échelle d’un territoire, fournit un cadre conceptuel pertinent pour cette évolution. Des outils juridiques innovants pourraient émerger pour encadrer ces flux de manière globale, au-delà des approches sectorielles actuelles.
Une protection juridique ancrée dans les territoires
Le renforcement du rôle des territoires semble incontournable. Plusieurs innovations juridiques pourraient y contribuer :
- Des mécanismes de péréquation entre territoires pour mutualiser les coûts et bénéfices de l’économie circulaire
- Des droits d’expérimentation élargis pour les collectivités territoriales
- Des contrats de symbiose industrielle territoriale juridiquement sécurisés
- Un droit à l’information environnementale locale renforcé
La justice environnementale devra être au cœur de cette évolution. Les territoires défavorisés supportent souvent une charge disproportionnée en matière de pollution et de déchets. Le cadre juridique de l’économie circulaire doit intégrer cette dimension et garantir une répartition équitable des bénéfices environnementaux et économiques de la transition.
Les innovations technologiques, notamment numériques, modifieront profondément les possibilités de traçabilité et de contrôle. La blockchain, les puces RFID ou les passeports numériques de produits permettront un suivi fin des matières tout au long de leur cycle de vie. Le cadre juridique devra s’adapter pour encadrer ces technologies, en protégeant notamment les données personnelles tout en garantissant la transparence des flux de matières.
Enfin, la dimension internationale ne peut être négligée. Les flux de matières dépassent largement les frontières nationales. Le droit du commerce international et les accords environnementaux multilatéraux doivent évoluer pour favoriser une économie circulaire mondiale, tout en évitant les transferts de pollution vers les pays aux législations moins protectrices. La Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux constitue une base, mais son champ d’application reste limité.
La protection juridique de l’économie circulaire territoriale se trouve ainsi à la croisée de multiples évolutions : décentralisation, numérisation, mondialisation, participation citoyenne… Son efficacité future dépendra de sa capacité à intégrer ces différentes dimensions dans un cadre cohérent, adaptatif et véritablement systémique.
