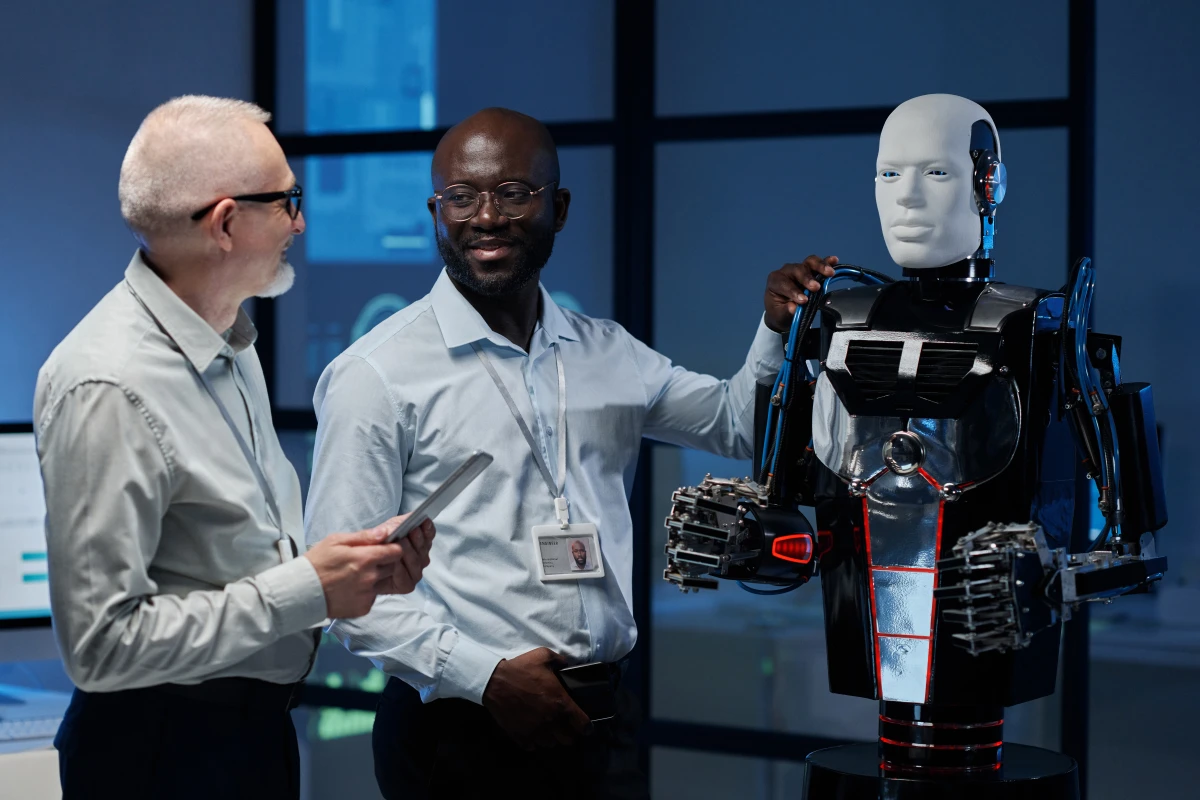Dans un contexte de changements constants, il est indispensable pour les avocats spécialisés en droit du travail de rester informés des dernières évolutions législatives. Cet article vous propose un tour d’horizon des principales nouveautés qui ont marqué ce domaine ces dernières années, ainsi que des conseils professionnels pour accompagner vos clients.
La réforme du Code du travail
La réforme du Code du travail est sans aucun doute l’un des sujets les plus marquants pour les avocats en droit du travail. Initiée par les ordonnances Macron de 2017, elle a profondément modifié le paysage juridique français en matière de relations professionnelles. Parmi les mesures phares figurent la fusion des instances représentatives du personnel, la création d’un barème obligatoire pour les indemnités prud’homales ou encore la réduction de certaines obligations pour les employeurs en matière de négociation collective.
Le renforcement de la lutte contre le harcèlement et les discriminations
Au cours des dernières années, une série de textes législatifs ont renforcé la lutte contre le harcèlement et les discriminations sur le lieu de travail. En particulier, la loi du 5 septembre 2018 (loi Avenir professionnel) a instauré plusieurs dispositifs visant à favoriser l’égalité professionnelle entre femmes et hommes (index égalité salariale) et à prévenir les violences sexuelles et sexistes au travail. De même, la loi du 24 juin 2020 a étendu les obligations de formation des représentants du personnel en matière de santé et sécurité, y compris sur ces thématiques sensibles.
Les nouvelles règles en matière de télétravail
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a conduit à une forte démocratisation du télétravail, avec des conséquences importantes pour le droit du travail. Ainsi, plusieurs textes juridiques ont été adoptés pour encadrer cette pratique et garantir un équilibre entre les droits et obligations des salariés et des employeurs. Parmi eux, citons notamment l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 26 novembre 2020 qui précise les conditions d’accès au télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou encore les mesures d’accompagnement nécessaires en termes d’équipement et d’organisation.
L’adaptation du droit social aux nouvelles formes d’emploi
Face à l’émergence de nouvelles formes d’emploi, telles que l’économie collaborative ou le travail indépendant, le législateur a également pris des mesures pour adapter le cadre juridique existant. Par exemple, la loi Travail de 2016 a introduit la notion d’entreprenariat salarial, tandis que la loi Avenir professionnel de 2018 a créé un statut spécifique pour les travailleurs indépendants qui utilisent des plateformes numériques (véritable contrat de travail, protection sociale, etc.).
Les enjeux liés à la protection des données personnelles
Avec l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en mai 2018, les entreprises et les salariés doivent désormais se conformer à des règles strictes en matière de traitement et de conservation des informations personnelles. Cela a un impact direct sur le droit du travail, notamment dans le cadre du recrutement, de la gestion des dossiers individuels ou encore de l’utilisation d’outils informatiques professionnels. Les avocats spécialisés doivent donc être en mesure de conseiller leurs clients sur ces nouvelles obligations.
Au vu des nombreuses évolutions législatives qui ont touché le droit du travail ces dernières années, il est essentiel pour les avocats d’être à jour et de maîtriser l’ensemble de ces thématiques pour offrir le meilleur accompagnement possible à leurs clients. Ainsi, se tenir informé et développer une expertise pointue sur ces sujets sera un atout majeur pour répondre aux enjeux actuels et futurs du monde du travail.